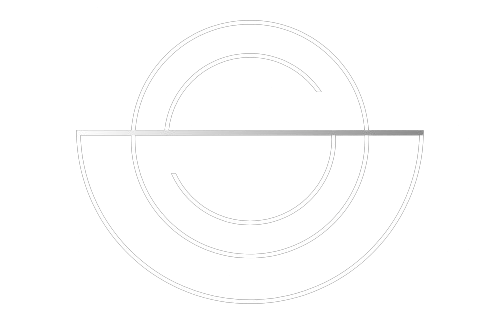Olivier Aïm est Maître de conférences en Sciences de l’information et de la communication au Celsa (Sorbonne Université). L’Observatoire de la surveillance en démocratie a souhaité le voir présenter sa leçon inaugurale. Le texte intégral ci-dessous a été proposé par l’auteur et retrace les principaux enjeux de l’étude de la surveillance en démocratie.
Observer la surveillance : état des lieux et perspectives
Le contexte dans lequel apparaît l’« observatoire de la surveillance en démocratie » est particulièrement riche pour les études surveillancielles. Nous vivons, en effet, le moment où l’économie des plateformes se redéfinit toujours plus fortement comme « capitalisme de surveillance » (S. Zuboff), où les pratiques sociales, les smart-technologies et les performances d’écran fondent les conditions numériques d’émergence de la « culture de la surveillance »[1], et où les méga-événements mondialisés et les crises géopolitiques impliquent toujours plus les dispositifs de biométrie et de renseignement. Toute cette actualité va de pair avec un grand nombre d’initiatives académiques pour la plupart très récentes, dans la mesure où, depuis quelques années, les colloques, les numéros de revues et les créations de groupes de recherche viennent, en effet, régulièrement répondre à cette sollicitation des terrains. Et c’est de manière tout à fait stimulante que cet « observatoire » fait maintenant son apparition pour combler une part qui était manquante dans le champ universitaire français et francophone.
Un « observatoire de la surveillance »
Tout d’abord, il conviendrait de noter que la forme « observatoire » équivaut en français à la formule anglo-saxonne du watching, que l’on retrouve dans les observatoires des pratiques et des violences policières, par exemple ; que l’on avait vue pendant la crise sanitaire avec l’« observatoire de l’état d’urgence » ; et que l’on retrouve encore plus anciennement avec l’observatoire des prisons[2]. En ce sens, l’observatoire est une forme qui remotive la logique contre-surveillancielle historique, celle qui vise non pas proprement à surveiller, mais à veiller sur les conditions du bon exercice de la démocratie et des droits fondamentaux.
Ensuite, l’observatoire constitue une forme scientifique particulièrement bien adaptée pour prendre la mesure de l’essor d’un objet de recherche aussi complexe que celui-ci. Le fait est que cet objet surveillance a la particularité d’évoluer en permanence avec la réalité empirique de ses technologies, de ses pratiques, de ses enjeux et de ses représentations. Et d’évoluer, d’autre part, en fonction des différents modèles théoriques qui cherchent à le décrire.
Dans cette perspective, on pourrait rappeler quelques étapes marquantes de cette histoire analytique : on noterait, ainsi, l’apparition au cours des années 1970 du concept d’« état de surveillance », qui débouche lui-même sur celui de l’« état de surveillance totale » de James Rule en 1973. C’est ensuite, bien évidemment, la notion de « dispositif de surveillance » qui s’impose avec la parution en 1975 de Surveiller et punir de Michel Foucault. Celle-ci débouche alors sur la notion de « société de surveillance » qui prédomine jusqu’aux années 2010, avant que n’apparaissent plus récemment les notions de « capitalisme de surveillance » et de « culture de la surveillance ».
En première analyse, on note, dans ces formulations, que la surveillance oscille entre une activité ponctuelle (ou la « réponse » à une « urgence » pour parler comme Foucault) et un état plus général, ou plus fondamental, en ce qu’il est relatif à la vie humaine, sociale et connectée de la population prise dans sa globalité. Dans une seconde analyse, plus opératoire, on observera que ces évolutions dans les appellations et, donc, dans les conceptions de la surveillance, sont significatives d’une difficulté épistémique et axiologique dans la manière d’appréhender cet objet. Ce que je veux dire par là, c’est qu’avec l’objet « surveillance », on est typiquement dans le cas d’une notion faussement évidente, typique de ce que Barthes aurait appelé un « mot-mana », un totem, un signe de reconnaissance, voire de connivence, mais dont les contenus varient – parfois de manière extrêmement forte – d’un individu à l’autre, d’une communauté (citoyenne, politique, scientifique) à l’autre, voire d’une discipline à une autre. Si bien que, faute d’une définition commune, la surveillance tend, selon Florent Castagnino[3], à faire prévaloir une « ontologie négative », qui finit par faire écran à l’analyse de la pluralité des processus, des phénomènes et des enjeux sociaux et politiques.
Pour le dire d’emblée, une des questions que je me pose actuellement est de savoir quels liens épistémologiques on peut tisser entre la surveillance de masse de type numérique et la notion de surveillance environnementale ou épidémiologique, par exemple ; entre la menace qui plane sur les processus d’agrégation des données de santé, d’un côté, et les logiques de surveillance sanitaire, de l’autre. L’un des intérêts majeurs d’un observatoire serait, ainsi, de s’inscrire dans l’actualité de ce double mouvement. En vue de constituer à la fois un espace d’attention vigilante concernant les excès technologiques de la surveillance de masse et un espace de réflexion et de recherche sur les conditions démocratiques d’une éthique de l’attention et de la vigilance.
Pour situer les contours des approches actuelles de la surveillance, il est utile de repérer quelques jalons historiques portant sur la manière dont la notion de surveillance est appréhendée, voire appréhendable. Pour ce faire, on peut repartir des cinq syntagmes de la surveillance : « dispositif », « société », « état », « capitalisme » et « culture ». Ce qui apparaît de manière simple, c’est que, depuis cinquante ans, l’appréhension de la surveillance est globalement passée de la surveillance comme technologie à la surveillance comme culture. Ce sont les deux temps que je vais présenter maintenant afin de revenir à des perspectives plus actuelles.
La surveillance comme technologie
Cette première mise en équivalence renvoie à l’histoire même de la constitution des Surveillance studies comme courant de recherche et à la place qu’y occupe Michel Foucault, qui, avec Surveiller et punir, fait advenir deux concepts dominants : le « panoptisme » et le « dispositif de surveillance ». Tout en annonçant le couple notionnel à venir de la « gouvernementalité » et du « biopouvoir » du fait même que le dispositif procède d’un primat technologique : « technologie du pouvoir », « technologie du corps », « technologie de la population ». Sous influence foucaldienne, les Surveillance studies vont puiser dans plusieurs modèles techno-orientés pour se façonner leur propre objet de connaissance. Il serait ainsi possible d’en dénombrer six : tout d’abord les quatre concepts d’« état de surveillance maximal » de James Rule[4], de « superpanopticon » de Mark Poster[5], de « dataveillance » de Roger Clarke[6] et de « tri panoptique » d’Oskar Gandy[7], qui forment le fond sur lequel vont se détacher les notions d’ « état de sécurité maximal » de Gary T. Marx[8] et celui de « surveillance phénétique » de David Lyon[9]. Ces deux derniers auteurs sont les bâtisseurs du champ des surveillance studies.
Dans un effort de synthétisation de ces six modèles, les Surveillance studies aboutissent alors à leur propre concept fondateur, la « nouvelle surveillance » (2002) (qui résonne avec les « nouvelles » technologies) et à une définition canonique (2007) : « l’attention ciblée, systématique et routinière portée à des informations [« details »] personnelles à des fins d’influence, de gestion, de protection ou de direction. »[10]. De sorte que, si elle date bien de quarante ans (comme l’indique dans le dernier numéro anniversaire David Lyon), l’histoire des Surveillance studies est marquée par une surdétermination, initiale et fondatrice, de la technologie, en vertu de la scansion suivante : télé-, vidéo-, cyber-, (big) data-surveillance. Cette scansion suit les trois temps de la donnée : l’informatisation des bases de données, la digitalisation des dossiers, l’algorithmisation des profils. Ce qui leur permet de rejoindre le concept central de « gouvernementalité algorithmique » déployé en 2013 par Berns et Rouvroy[11].
Il s’ensuit que du point de vue analytique, on assiste au sein des Surveillance Studies à une course-poursuite après les développements technologiques et les questionnements éthiques et juridique qu’ils posent. Autrement dit, à ce que Foucault nomme lui-même dans Surveiller et punir les « seuils technologiques ». Pour illustration, il est ainsi possible de voir combien les grandes questions biopolitiques se présentent depuis 1975 au sein des surveillance studies comme des grandes questions techno-biopolitiques : la télésurveillance puis la vidéosurveillance avant que les algorithmes et l’IA ne réactualisent cette question en termes de « reconnaissance faciale » ; les fichiers informatiques[12] ; les puces RFID ; les outils de géolocalisation ; le Big Data ; les algorithmes ; les plateformes ; la biométrie en général, et ainsi de suite. Ces seuils technologiques procèdent souvent de débats, de controverses, de crises ou de scandales : citons ici le cas du 11 septembre 2001 et du Patriot Act, les révélations de Snowden sur la NSA, le scandale Cambridge Analytica, celui plus récent des logiciels espions (Pegasus, Briefcam, etc.) ou la crise du COVID et la perspective des Jeux Olympiques de Paris 2024. Cette actualisation permanente constitue l’un des ferments du dynamisme du champ, mais aussi l’une de ses limites théoriques, dans la mesure où la technologie favorise un déterminisme commode pour aborder la surveillance à la faveur de ses urgences, de ses crises, de ses injonctions, de ses exceptionnalités, de sa banalisation, mais aussi de ses dystopies ou de ses « envoûtements »[13]. Or, ce qui risque de passer à la trappe dans cette approche techno-centrée, c’est tous les pans de la vie quotidienne, sociale, personnelle et peut-être même pulsionnelle de la surveillance : la sociabilité, la santé, le travail, la famille, la parentalité, l’école, le divertissement, le loisir, entre autres. Les surveillance studies ont tenté de compenser et de corriger ce biais par la prise en compte progressive de la vie de tous les jours, selon un double tournant social et ethnologique de la surveillance. Mais il demeure toute une fascination pour la technique qui se fait parfois au détriment de la prise en compte de ses appropriations, de ses acceptabilités, voire de ses désirs. Le champ des études sur la surveillance est riche, foisonnant, mais il a sous-estimé, et sous-estime peut-être encore en partie, le poids des usages et des désirs, malgré l’importance du concept d’« agencement »[14]. Au fond, on a préféré chez Deleuze le modèle des « sociétés de contrôle » (1988) à celui de l’« agencement ». J’y reviendrai plus loin.
Et c’est là que le rôle de Foucault reste écrasant. Outre la captation de l’héritage benthamien, il a en quelque sorte frappé l’analyse de la surveillance d’un interdit, directement énoncé dans Surveiller et punir : « Notre société n’est pas celle du spectacle, mais de la surveillance. ». Il s’agit là de la seule évocation au présent de l’énonciation dans le texte de Foucault, qui sonne comme une maxime, selon laquelle tout le périmètre de l’« économie politique de la visibilité » est déterminé par les enjeux de surveillance. Or, là où Foucault scindait, pour mieux les opposer, les deux économies de la visibilité, il est actuellement nécessaire de les articuler. Historiquement et synchroniquement ! D’où une nouvelle mise en équivalence : la surveillance comme culture.
La surveillance comme culture
Le pouvoir renvoie à la question de la visibilité. Il suffit d’écouter notre époque pour constater combien le geste premier de l’action politique consiste, dorénavant, à « rendre visibles » des pratiques « invisibilisées ». Tel est le cœur des enjeux analytiques et pragmatiques de l’ensemble des questions et des débats publics. Or, pour les rendre visibles, le passage par leur médiatisation (et leur spectacularisation) est devenu nécessaire. A ceci près que les opérateurs médiatiques sont de plus en plus nombreux et divers : à côté des médiateurs traditionnels (médias journalistiques), on trouve tous les nouveaux infomédiaires, tous les collectifs militants, et, plus généralement encore, toutes les pratiques individuelles dès lors que les citoyens se trouvent équipés d’outils de captation, d’édition, de diffusion des images notamment.
Pour prendre la mesure de cette nouvelle grammaire de l’action publique, les travaux récents font le pari épistémologique, voici en tout cas ma lecture et mon hypothèse, de réconcilier les deux versants de l' »économie politique de la visibilité », qui reste la grande découverte de Surveiller et punir : la surveillance et le spectacle ! Je citerai trois auteurs et autrices déjà évoqués : Bernard Harcourt et la société de l’exposition (2017)[15] ; Shoshana Zuboff et le capitalisme surveillanciel (2019), qui consiste à rendre visible le « texte invisible » des traces des utilisateurs que captent les plateformes ; David Lyon et la « culture de la surveillance » (2018), qui met au jour l’ensemble des pratiques et des représentations qui façonnent le monde numérique des individus connectés.
Au-delà de ces exemples importants, il est encore possible d’observer à quel point les nouvelles approches de la surveillance procèdent toutes d’une boucle de rétroaction du spectaculaire sur le surveillanciel. Si l’on reprend, en effet, les approches traditionnelles de la surveillance (politique, juridique, sociologique, médiatique, économique), on ne peut que constater ce processus à l’œuvre dans les approches actuelles :
- Le spectacle reversé sur l’approche politique donne toute la piste « contre-visuelle » des visual studies et notamment de Nicholas Mirzoeff[16] qui engage un « droit de regard » au double sens du terme : la logique de résistance à la surveillance et l’application d’un autre regard, contradictoire, sur les conflictualités et leur histoire.
- Le spectacle reversé sur l’approche juridique donne tout le travail sur le « legal design » autour de la privacy. Où l’on voit que le cœur des enjeux porte sur la dialectique entre (se) rendre visible ou non, à travers le design des interfaces, les pratiques de « dark pattern » ou du « shadow banning » et, à l’inverse, les tactiques et les ruses des utilisateurs décrites sous le nom générique d’« obfuscation »[17]. Tout ceci relevant de ce que j’appelle la « pragmatique de la visibilité », qui nécessite en effet de prendre en considération les médiations, les supports, les outils, les interfaces, les médias, au même titre que les affordances, les injonctions et les désirs qui les traversent.
- Le spectacle reversé sur l’approche sociologique donne l’hypothèse de la surveillance interpersonnelle via les outils de communication. Depuis la surveillance « latérale » de Mark Andrejevic, les travaux ne cessent de se développer autour des enjeux de la « surveillance sociale »[18] notamment au sein de la sociabilité et de la famille[19].
- Le spectacle reversé sur l’approche médiatique et esthétique donne l’art surveillanciel (ou artveillance) qui repose sur une relecture de la place de l’image : cinématographique, vidéo ou encore photographique[20]. Et c’est là que l’on mesure à nouveaux frais la richesse et la diversité des disciplines engagées dans l’étude de la surveillance. La dimension médiatique et sociale des nouvelles performances d’écran a, ainsi, partie liée avec l’histoire et l’art, à travers les régimes de représentation et de contre-représentation. Ce que Steve Mann avait évoqué dès l’origine de la revue Surveillance & society sous le nom de « réflectionnisme »[21], et qui est monté en puissance depuis lors à travers les références et les pratiques autour de la « sousveillance »[22] et du watching, qiui se situent précisément à l’articulation des enjeux esthétiques et politiques de la « visualité » sociale.
- Le spectacle reversé sur l’approche économique donne l’hypothèse du capitalisme de surveillance de Zuboff déjà plusieurs fois citée. Mais aussi d’autres approches portant sur le travail et la consommation. En dépassant la dichotomie foucaldienne, on assiste au retour du refoulé publicitaire. Les derniers textes de Bernard Stiegler ont beaucoup œuvré à leur émergence de ce point de vue lorsqu’il pointait l’oubli des disciplines de consommation et de marketing chez Foucault.
Dans cette optique, j’aimerais donner un autre exemple dans l’histoire récente des écrans et des plateformes, à savoir celui de Netflix. Sans retracer toute l’histoire de cet acteur économique devenu emblématique de l’économie des plateformes, il est possible de rappeler qu’il s’impose dans l’écosystème numérique autour des années 2010 quand il propose un nouveau mode consommation des contenus audiovisuels, à commencer par les séries télévisées. Précisément définies par leur diffusion sur les « chaînes » de télévision, gratuites ou payantes, ces « contenus » procédaient d’une véritable « discipline » de consommation, totalement déterminée par le principe de l’épisode. Chaque semaine, la chaîne de télévision diffuse un épisode à jour et heure fixes. Le corps du consommateur est alors invité à se retrouver devant un écran (généralement un téléviseur) pour honorer ce rendez-vous. La logique de consommation culturelle ressortit à une logique de programmation. La promesse de Netflix est de « libérer » le consommateur de cette discipline : en somme, de le libérer de la chaîne et de son panoptisme. Surfant sur les pratiques déjà repérées par les acteurs économiques du « binge wtaching », Netflix délivre dorénavant ses séries d’un seul bloc, en mettant en ligne la totalité des épisodes constituant une « saison ». On pourra noter que la logique de rendez-vous demeure, puisque les fans ou les consommateurs de séries attendent maintenant le moment de l’année où la saison arrive dans sa totalité, plutôt que le moment de la semaine où l’épisode est diffusé. Il reste que ce qui est passionnant pour l’étude de la consommation culturelle est qu’elle rejoint celle de la surveillance. Et ce pour au moins cinq raisons. Premièrement, l’expérience culturelle est ainsi clairement reliée à des enjeux de disciplines de consommation et d’attitudes commerciales autour de ces disciplines (la programmation versus le binge watching). Deuxièmement, le profilage algorithmique s’impose ici comme une relation complémentaire à la discipline audiovisuelle qu’elle semble remplacer, dans la mesure où la promesse de libération des corps programmés par la rythmique épisodique est assortie d’une autre promesse : celle de la personnalisation des contenus pour chaque individu. Troisièmement, cette promesse de personnalisation réalise pleinement le projet algorithmique en tant que gouvernementalité, puisqu’elle repose sur un « calcul » des goûts des consommateurs et une économie constante de la recommandation. Quatrièmement, l’algorithme a pour fonction de calculer les modes de consommation des séries dans le but de favoriser les contenus produits par Netflix, mais aussi le « style visuel » de chaque profil. Ce style visuel correspond à la manière dont les profils sont conçus et apparaisse pour flatter non seulement le goût culturel de l’internaute, mais aussi son goût sémiotique : à travers une très multitude de « vignettes » et de « jaquettes » possibles, chaque contenu audiovisuel (films, séries, documentaires) apparaît en fonction des préférences visuelles et diégétiques de l’utilisateur (le contenu sera présenté à travers une scène, une image, un ou plusieurs personnages, un décor, etc. qui s’aligne sur ses goûts calculés par la machine). Cinquièmement, cette logique générale de la plateforme voit converger de manière quasi parfaite les deux économies de la visibilité repérées par Foucault : le surveillanciel et le spectaculaire. La sémiotisation des profils se fait en fonction de la traçabilité des usages. Et la société de surveillance rejoint la société du spectacle…
Des dispositifs aux agencements de la surveillance
Tous ces exemples montrent avec quelle puissance heuristique nous vivons un tournant culturel massif dans le champ des études surveillancielles. Je voudrais toutefois apporter deux réserves, ou plutôt deux précautions à ce constat :
- Tout d’abord, il ne faudrait pas tomber maintenant dans le travers inverse du refoulement spectaculaire, en escamotant ou en relativisant l’importance des enjeux biopolitiques : il n’est que de citer le cas de la santé ou de la crise sanitaire nous l’a rappelé de manière éclatante. D’ailleurs, David Lyon publie en 2022 après La culture de la surveillance un ouvrage tout à fait clair à cet égard : Pandemic Surveillance. De manière plus large encore, des pans entiers des études et des théories surveillancielles émergent et doivent se développer autour des questions suivantes : la ville et les données urbaines (de la smart à la safe city), les grands événements et leurs exceptionnalismes durables (les J.O. à venir et la question de la reconnaissance faciale, bien entendu et du motif de l’expérimentation), le travail et le management, la géolocalisation, l’anticipation et la classification des normes de comportements, pour ne citer que les principales.
- Au fond, il semble que sur le plan de la surveillance, nous nous retrouvons dans une situation analogue à celle qui se joue dans les conceptions du pouvoir. Nous avons longtemps cru que nous étions passés du hard power au soft power. Le mouvement que j’ai esquissé nous a conduits, parallèlement, sur la piste d’un passage vers le soft control et la soft surveillance (dans le prolongement, d’ailleurs, de l’hypothèse générale de Surveiller et punir de « l’adoucissement des peines » en faveur des disciplines). En réalité, il convient d’éviter la tentation de substituer ces deux approches de la surveillance l’une à l’autre, au risque de favoriser l’un ou l’autre des deux réductionnismes corollaires. Mais plutôt de plaider pour une dimension dialectique, ou plutôt complexe de l’étude de la surveillance. Et là encore je voudrais revenir à la piste de la consommation et, plus particulièrement, au cas du commerce où les logiques actuelles de fidélisation, de veille des comportements d’achats, de recommandation et de traçage en ligne se doublent de logiques très « physiques » de suivi des déplacements au sein des espaces marchands et d’intensification des logiques biométriques en ce qui concerne les technologies de paiement et de passage en caisse[23]. Pour le dire de manière nette, la « nouvelle surveillance » – soit la dataveillance ou la big data surveillance – n’a pas tué la surveillance plus traditionnelle. Tant s’en faut !
L’ensemble de ces précautions analytiques nous permettent de revenir à la notion plus que jamais centrale d’agencement surveillanciel (Ericson et Haggerty, 2000) pour prendre pleinement en compte les phénomènes de surveillance dans toute leur complexité. D’abord parce que la notion d’agencement a l’avantage de faire entendre le primat des agentivités : de la soumission et de l’injonction à la participation.
La notion d’agencement permet, en outre, d’échapper à l’écueil épistémologique de la « tapisserie des concepts » dont parle Gary T. Marx en 2015[24], à savoir le recours aux formules figées du type : « panoptisme 2.0. », « synoptisme », « cryptopticon », ou, plus récemment, « academicon », « synhaptisme » ou « platopticon »… A rebours de ces modèles réifiants et faussement explicatifs, il convient de plaider pour la pluralité, la diversité et l’hétérogénéité des agencements. C’est d’abord la diversité des valences qui traversent les agencements : la mobilité, le contrôle, le divertissement, le désir de surveillance de l’autre (la parentalité, la sociabilité…) et le désir d’être surveillé, calculé, monitoré, panoptisé (le cas du « quantified self » et le cas de la reconnaissance faciale). C’est ensuite la diversité des agentivités, telles qu’elles sont mobilisées dans les différents modèles socio-politiques de la transparence, de la participation, de la « shareveillance », de la vigilance, de la contre-surveillance, du signalement, etc. C’est enfin la diversité des corps de la surveillance qu’il faut évoquer : l’un ne s’est jamais substitué à l’autre. Il suffit de reprendre les exemples de tout à l’heure : le covid, la ville, la consommation ou le commerce. De même que le design, les plateformes, les algorithmes ont révélé l’importance que l’on doit accorder au « double de données »[25] et de sa sémiotisation.
Voilà pourquoi il faut creuser, selon moi, toute la spécificité de l’objet surveillance pris dans la complexité de ses « agencements », c’est-à-dire de ses agentivités et de ses valences, c’est-à-dire encore de ses effets et de ses visées. La complexité est alors à prendre en compte au sein même des régimes surveillanciels : comme le montre Olivier Razac[26], le contrôle ne s’est pas substitué à la discipline, qui n’a pas disparu, comme modalité surveillancielle, ainsi qu’on a pu l’observer pendant la crise sanitaire.
Ouvertures
Dans le prolongement du spectacle, de l’économie, du design, des médias, il me paraît utile de finir sous forme d’ouverture en opérant la distinction entre la surveillance et le « surveillanciel ». D’un point de vue lexicologique, surveillance est un déverbal qui, en se faisant substantif, a développé à la fin du 18ème siècle : un « signifié de puissance » autour des questions policières, militaires, juridiques et pénitentiaires, associée à la notion de risque et de sécurité ; et une « prédilection » sémantique pour la dimension verticale et panoptique de la surveillance.
Si la dimension « gouvernementale » et « géopolitique » de la surveillance n’a évidemment pas disparu, il est indispensable de prendre en compte la pluralité des surveillances, de leurs modalités, de leurs intensités et de leurs agencements. L’ensemble de ces enjeux – que l’on désigne généralement par le caractère « liquide »[27], pervasif, ubiquitaire, social, rhizomatique, datafié, algorithmique ou capitalistique de la surveillance – renvoie, en réalité, à des processus et des manifestations diffuses, discrètes, adoucies, banalisées. Voilà pourquoi, dans le prolongement de ces nouveaux agencements surveillanciels, il est nécessaire de prendre en considération la dimension vécue de la surveillance. Loin d’être uniquement subie, la surveillance est dorénavant agie, négociée, partagée, performée.
Du point de vue pragmatique, cela se traduit par des travaux nombreux sur les différentes appropriations de la surveillance, sur les pratiques, sur les dispositifs qui pourraient engager sur des formats et des formules moins attentatoires, moins intrusives, moins opaques, bien évidemment ; et peut-être plus « éthiques » ou vertueux. Plusieurs champs se sont ouverts dans cette perspective : l’épidémiologie, la biodiversité, l’éducation, la ville sont ainsi devenus des domaines où la surveillance se présente comme l’enjeu majeur relativement à la question des données et des conditions de leur captation, de leur exploitation et de leur partage.
La piste « surveillancielle » offre ainsi l’avantage de conduire les recherches sur la piste renouvelée « des » surveillances et de l’attention qu’il incombe de porter sur la pluralité des enjeux sociaux, politiques et culturels de la surveillance comme droit, comme revendication et, peut-être même, comme soin. Ceci doit nous conduire à évaluer, examiner, mettre en réseau les surveillances autres, à commencer par celles qui s’inscrivent dans les perspectives environnementales, sanitaires, éthiques de la responsabilité partagée entre les regards du pouvoir et ceux de la population. Ceci rend ainsi d’autant plus crucial l’évaluation des pratiques et des regards en jeu, ainsi que peut le faire un observatoire comme l’OSD.
[1] David Lyon, The Culture of Surveillance: Watching As a Way of Life, Polity Press, 2018
[2] qui prolonge d’une certaine manière le « Groupe d’information sur les prisons » (ou GIP) fondé en 1971 par Michel Foucault, Jean-Marie Domenach et Pierre Vidal-Naquet.
[3] Florent Castagnino, “Critique des surveillance studies. Eléments pour une sociologie de la surveillance”, Deviance et Société, volume 42, 2018.
[4] James B. Rule, Private Lives and Public Surveillance. Social Control in the Computer Age, Schocken Books, 1973
[5] Mark Poster, The Mode of Information: Post-Structuralism and Social Context, Polity Press, 1990
[6] Roger Clarke, « Dataveillance », http://www.rogerclarke.com/DV/
[7] Oskar Gandy, The Panoptic Sort: A Political Economy of Personal Information, Westview Press, 1993.
[8] Gary T. Marx, Undercover. Police surveillance in America, 1988
[9] David Lyon, « Surveillance studies: Understanding visibility, mobility and the phenetic fix », Surveillance & Society, Vol 1 n°1, 2002
[10] David Lyon, Surveillance Studies: An Overview, Polity Press, 2007
[11] Antoinette Rouvroy et Thomas Berns, « Gouvernementalité algorithmique et perspectives d’émancipation. Le disparate comme condition d’individuation par la relation ? », Réseaux, n° 177, 2013
[12] Cette approche par la donnée personnelle est évidemment liée à une tradition réglementaire, celle de l’encadrement légal lié au scandale du dossier SAFARI de 1972 et la naissance de la CNIL. Une tradition de réflexivité qui reste avec le Linc, laboratoire de la CNIL ; c’est la tradition française finalement : Cnil, identification, biométrie, interopérabilité, fichage ; le droit et les SIC + Didier Bigo.
[13] Yves Citton, Médiarchie, Seuil, 2017
[14] Kevin D. Haggerty et Richard V. Ericson, « The surveillant assemblage », The British Journal of Sociology, 2000
[15] Bernard E. Harcourt, La Société d’exposition, Seuil, 2020
[16] Nicholas Mirzoeff, Right to Look. A Counterhistory of Visuality, Duke University Press, 2011.
[17] Helen Nissenbaum et Finn Brunton, Obfuscation, C&F Editions,2019
[18] Alice Marwick, « The Domain Public : Social Surveillance in Everdyday Life », Surveillance&Society, 2012
[19] Yann Bruna, « Géolocalisation des pairs à l’adolescence et enjeux relationnels. Les usages sociaux de la SnapMap », Questions de communication, n°42, 2023 ; « Usages et enjeux de la géolocalisation dans le contexte de la surveillance parentale », Tic & Société, Vol.16, 2022.
[20] Colloque « Photographie et surveillance », 26 et 27 octobre 2021, INHA.
[21] Steve Mann, Jason Nolan, Barry Wellman, « Sousveillance : Inventing and Using Wearable Computing Devices for Data Collection in Surveillance Environnements », Surveillance & Society, Vol 1 n°3, 2003.
[22] Jean-Paul Fourmentraux, Sousveillance, Presses du reel, 2023.
[23] Joseph Turow, The Aisles Have Eyes: How Retailers Track Your Shopping, Strip Your Privacy, and Define Your Power, Yale University Press, 2017
[24] Gary T. Marx, Surveillance Studies Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA, 2015
[25] Kevin D. Haggerty et Richard V. Ericson, « The surveillant assemblage », The British Journal of Sociology, 2000
[26] Olivier Razac, Une société de contrôle ?, Kimé, 2023
[27] Zygmunt Bauman, « Devoir de protection, protection des libertés : entre « surveillance liquide » et politiques sécuritaires », entretien avec Olivier Hassid, in Politiques sécuritaires et surveillance numérique, « Les Essentiels d’Hermès », CNRS Editions, 2014.